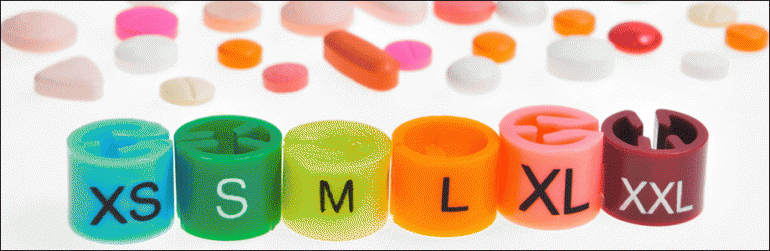Selon une revue de près de 100 études menées à travers le monde, et incluant environ 3 millions d’individus, la relation entre obésité et mortalité ne serait en réalité pas linéaire, ce qui entretient la thèse naissante du paradoxe de l’obésité.
 Récemment, des études portant sur la relation entre IMC, diabète et mortalité ont semé le doute dans le monde médical, dans la mesure où celles-ci avaient montré un risque de mortalité plus élevé chez des diabétiques de poids normal, que chez ceux en surpoids ou obèses. Certains experts ont alors évoqué le concept de «paradoxe de l’obésité», dont la réalité de l’existence se mesure désormais avec de nouveaux chiffres assez éloquents.
Récemment, des études portant sur la relation entre IMC, diabète et mortalité ont semé le doute dans le monde médical, dans la mesure où celles-ci avaient montré un risque de mortalité plus élevé chez des diabétiques de poids normal, que chez ceux en surpoids ou obèses. Certains experts ont alors évoqué le concept de «paradoxe de l’obésité», dont la réalité de l’existence se mesure désormais avec de nouveaux chiffres assez éloquents.
Dans cette étude publiée dans l’édition de janvier du JAMA, les auteurs ont fait l’inventaire des études analysant la relation entre IMC et risque de mortalité toutes causes. 97 études menées sur 4 continents incluant 2.880.000 individus, et enregistrant 27.000 décès, ont rencontré les critères d’inclusion.
En comparaison d’un poids normal (IMC entre 18.5 et 25), la surcharge pondérale (IMC entre 25 et 30) est associée à une réduction significative du risque de mortalité de 6%, alors qu’en cas d’obésité (IMC supérieur à 30), ce risque est accru de 18%. L’analyse des différents grades de l’obésité apporte aussi des nuances: l’obésité de grade 1 (IMC de 30 à 35) est associée à un risque plus faible de 5%, alors que les grades 2 et 3 élèvent le risque de 29%.
Pour les auteurs, ce seraient donc les formes d’obésité les plus sévères qui augmenteraient le taux de mortalité en comparaison d’un poids sain. Un léger embonpoint pourrait apporter une protection, par une meilleure connaissance de la prise en charge médicale par le patient, des effets métaboliques cardioprotecteurs de la graisse ou simplement les bénéfices de réserves de graisse dans la résistance face à la maladie.
Katherine M. Flegal et al., JAMA. 2013; 309(1): 71-82.